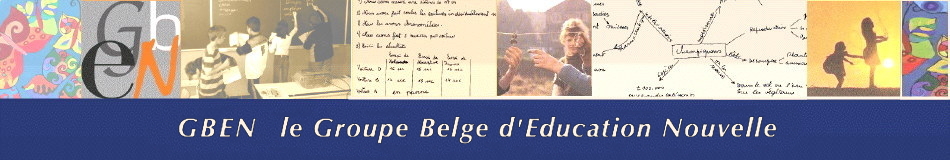Philippe Eenens, astrophysicien, vit au Mexique depuis 1992. Il fait de la recherche sur les étoiles binaires et donne cours à l’université de Guanajuato. Passionné par l’enseignement, il lancé un groupe d’Education Nouvelle au Mexique. Il anime régulièrement des formations pour instituteurs et professeurs. On le voit souvent eu milieu d’une classe primaire de milieux populaires.
Voici des extraits du premier chapitre de son livre "Un Regard Latino sur l’Education Nouvelle" publié en 2009 et disponible au GBEN (082 699 576 - tél. et fax) au prix de 10 €.
Franchement nous vous le recommandons : tout simple, à la portée de tous et percutant, sa lecture en vaut vraiment la peine.
Voici les références du livre :
Copyright Ph. Eenens, 2009
Guanajuato, eenens at gmail.com
ISBN : 978-2-9600887-1-7
LES MULTIPLES FACETTES DES SAVOIRS
Dans un village Mexicain
- Nos élèves commencent leurs additions du mauvais côté, m’explique un groupe d’enseignants. Nous avons mis au point des méthodes d’apprentissage pour les aider.
Leurs élèves, ce sont des adultes qui n’ont pas terminé l’école primaire. Ce sont des femmes, la plupart mères de famille. La vie leur a appris à calculer : pour évaluer la longueur d’un tissu, la quantité de matériaux de construction, la valeur d’une récolte ou le montant de leurs courses. Mais elles ont besoin d’un diplôme pour trouver un emploi.
Comment s’y prennent-elles pour faire des additions ? Elles commencent tout naturellement par les centaines, puis les dizaines, puis les unités. C’est plus intuitif : cela correspond aux manipulations concrètes d’objets ou d’argent. Pour compter 253 pesos, commencerait-on par les trois pièces de un ? Et pèserait-on d’abord les pommes éparses avant les sacs pleins ?
Cette manière de calculer est à l’opposé de ce qu’on enseigne à l’école. Selon les manuels scolaires, on doit d’abord ajouter les unités, puis on passe aux dizaines, etc. Si la somme des unités dépasse 10, il y aura une « retenue » qui affectera le chiffre des dizaines. En additionnant de droite à gauche, on peut le prévoir. Mais si on commence par les dizaines, on ne sait pas d’avance s’il faudra ajouter une retenue et donc on devra souvent se corriger et raturer son cahier. C’est ce que font les adultes qui n’ont pas appris à l’école.

- Voilà l’obstacle épistémologique, font remarquer les enseignants. Le fait qu’elles utilisent une méthode incorrecte, c’est cela qui rend difficile l’apprentissage. Nous avons dû faire preuve de beaucoup de patience pour les amener à changer.
Pourquoi les méthodes scolaires devraient-elles être les seules correctes ? Pourquoi le savoir des mères de famille serait-il inférieur ? Leur façon de calculer a fait ses preuves, elles l’emploient tout le temps. Pour elles, c’est ce qui a le plus de sens. L’école déracine les méthodes qui leur sont propres pour transplanter une méthode venue d’ailleurs. Pourquoi ?
Ce groupe d’enseignants était certain que les méthodes autochtones ne pouvaient pas être aussi bonnes que celles des livres, c’est-à-dire celles que dicte le ministère de l’éducation. Les mères de famille aussi en étaient probablement convaincues. Pourtant rien ne le prouve. Au contraire, ce qui a de la signification pour l’apprenant est toujours meilleur.
Cette attitude est très fréquente. Elle recouvre un préjugé fortement ancré dans les esprits, aussi bien chez les enseignants que chez les apprenants, qu’ils soient adultes ou enfants : que les élèves arrivent à l’école sans rien savoir de bon.
Cette idée préconçue a des conséquences graves. Non seulement parce qu’elle rend l’apprentissage moins efficace, mais surtout parce qu’elle rabaisse la pensée propre des élèves, nie la valeur de ce qu’ils apportent et leur fait croire que leur façon de voir est forcément erronée. On les fait renoncer à leurs savoirs naturels, à leurs représentations mentales, à leurs acquis personnels. Leurs points de vue sont gommés d’un trait, dorénavant ils doivent penser comme on leur dit. Ce qui est présenté comme rupture épistémologique n’est-il pas souvent une rupture sociale ?
Ce groupe d’enseignants avait déployé de grands efforts pour aider les mères de famille à apprendre la « bonne » méthode. Ils y réussirent. Toutes acquirent la compétence recherchée. Mais à quoi bon ?
Peu importe si l’enseignant supprime les cours magistraux et s’en tient au rôle de facilitateur. Peu importent les techniques pédagogiques qu’il emploie, le matériel didactique qu’il utilise, les méthodes d’évaluation qu’il propose. Peu importe si l’apprentissage se fait en groupes, de manière significative, active et constructive. L’effet est le même : l’élève est mis à sa place d’élève, c’est-à-dire d’ignorant.
Dans cette perspective, l’apprenant doit se soumettre aux méthodes des livres, il doit assimiler ce qu’il lit et ce qu’on lui dit. Bref, il doit se plier à une norme. Ce n’est pas lui qui décide des programmes d’étude. En fin de compte, ce qu’il acquiert, c’est une certaine perception du rôle des savoirs, de la fonction des enseignants et de la place qui lui est réservée.
L’apprenant acquiert inconsciemment une certaine perception de l’organisation sociale.
L’école ne transmet pas seulement des savoirs et des compétences, toutes transversales et citoyennes qu’elles soient. Elle inculque une vision de la société et de la place que chacun y occupe. Elle contribue à fixer dans les esprits l’idée d’une certaine organisation sociale.
Quelle est le modèle sociétaire que propage l’école ?

Traditionnellement, les connaissances sont présentées comme un bagage qu’on transmet. Dans une vision un peu moins passive, le savoir est considéré comme un lieu auquel il faut accéder et dans lequel il faut entrer pour s’y former. C’est bien ce que disent les expressions « accès au savoir » et « se construire dans le savoir ». L’enseignant est alors celui qui détient le savoir ou bien celui qui favorise l’entrée dans les domaines savants. Dans les deux cas, l’apprenant est vu comme celui qui ne sait pas, soit parce qu’il est un récipient vide, soit parce qu’il se trouve encore en dehors des zones du savoir.
Les conséquences d’une telle vision vont bien au-delà de l’école. Elle renforce l’idée de dépendance (l’apprenant a besoin de l’école). Elle souligne son infériorité (il est celui qui doit apprendre, quelle que soit d’ailleurs la capacité qu’on lui en reconnaît). Elle définit les rôles (chacun doit prendre la place qui lui est assignée). Elle véhicule une conception de la vérité universelle et absolue (on apprend tous la même chose).
J’ai besoin de l’école pour apprendre,
j’y prends ma place d’élève,
j’y étudie ce qu’on me dit,
nous apprenons tous la même chose.
Autant d’idées qui renforcent une certaine organisation sociale.
Le maintien des structures inégales d’une société n’est possible que si ses membres sont guidés par des perceptions mentales qui leur font accepter ces structures. Ces perceptions ont pour fonction d’occulter ce qui autrement rendrait les injustices intolérables. Leur effet est d’autant plus puissant qu’elles restent inconscientes. C’est dire combien elles paralysent toute tentative d’action transformatrice.
Ne pourrait-on pas concevoir un modèle différent de l’éducation ?
Dans une vision tout à l’opposé, chacun apportera ses connaissances, ses compétences et ses façons de voir. L’enseignant sera le point de contact par lequel les savoirs du monde entier seront rendus présents. Dans la rencontre qui s’en suivra, tous ces savoirs anciens seront remis en question et acquerront un sens neuf puisqu’ils seront repensés par un groupe nouveau.
Car un savoir n’est pas figé. Il est vivant, comme un organisme qui grandit et s’adapte au milieu où il se trouve.
Les savoirs sont vivants, ils grandissent, ils s’adaptent à leur milieu.
Mais le théorème de Pythagore ne change pas, objectera-t-on. C’est vrai, s’il est vu dans sa nudité squelettique. Il remonte au moins aux Babyloniens, deux mille ans avant le vénérable Pythagore. Mais sa signification doit être réinventée chaque fois que de nouveaux regards l’interrogent. Que veut-il dire aujourd’hui pour nous qui voulons dessiner une frise maya ou construire un local pour notre coopérative ?
Ainsi le théorème de Pythagore s’orne de nouvelles couleurs selon la culture qui est la nôtre et selon l’usage particulier auquel nous voulons le soumettre. Même si on reste au niveau de la pure abstraction mathématique, ce théorème a des visages multiples. Au cours de l’histoire, on l’a habillé de plus de trois cents démonstrations, une pour chaque jour de l’année, de quoi satisfaire le plus gourmand des connaisseurs. Chacune en illustre une nouvelle facette, selon le point de vue son inventeur. Ce processus ne s’achève jamais. On n’a jamais fini de comprendre un théorème.
Mais qu’est-ce que comprendre ?
Comprendre ce n’est pas répéter sagement ce que j’ai appris. Comprendre, c’est pouvoir me servir de mes connaissances pour résoudre de nouveaux problèmes, c’est pouvoir les appliquer dans de nouveaux contextes, c’est pouvoir les re-créer comme quelque chose d’entièrement neuf face à l’imprévu d’une situation qui me présente un défi.
Il s’agit donc de pouvoir.
C’est dire que l’apprentissage ne peut être confiné à la sphère du cognitif. Le savoir doit faire ses preuves dans l’action. Il est notre réponse aux questions que la vie nous pose. Cette réponse n’est pas quelque chose que nous possédons, mais bien un être nouveau que nous devenons. Car ce ne sont pas les outils (les savoirs) qui réalisent les actions, mais les personnes (les savants).
Les savoirs doivent faire leurs preuves dans l’action.
Apprendre, ce n’est donc pas seulement une question de savoirs ou de compétences. Apprendre c’est se transformer soi-même pour pouvoir transformer le monde.
Telles sont les questions que se pose l’éducation nouvelle.